Rien de plus injuste que l’inégalité de santé, surtout en France, ou l’égalité est le fondement de notre société. Et pourtant ! Les inégalités de santé sont bien là.
Trois mécanismes participent à la construction de ces inégalités de santé, tout au long de la vie.
D’abord, selon les conditions de vie et de travail, l’exposition plus ou moins importante au risque est forte. Un ouvrier du bâtiment ou un employé d’industrie chimique auront davantage de risques qu’un employé de bureau, pour certaines maladies ou accidents.
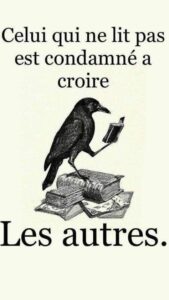
Ensuite, on retrouve la perception des symptômes. Les hommes vont être surtout sensibles aux symptômes qui touchent au fonctionnement du corps. Les femmes seront plus attentives à des symptômes comme la fatigue qui perturbe leur rôle social. Quand les femmes se plaignent d’anxiété, de fatigue et de douleurs à la poitrine, le médecin a tendance à minimiser alors qu’elles sont tout de suite prises au sérieux chez les hommes pour un risque cardio-vasculaire.
L’inverse est aussi vrai. Alors qu’un tiers des fractures à la hanche chez les hommes sont imputables à l’ostéoporose, très peu d’entre eux bénéficient d’un traitement contre cette maladie qui reste « une maladie de femmes ». Autant de biais imputables aux représentations genrées des maladies.
NB : déjà, des études américaines ont été accusées de ne faire des essais cliniques que sur des hommes caucasiens. Très peu ou jamais sur des femmes ou des noirs.
La chercheuse Nathalie Bajos, directrice de recherche à l’Inserm et directrice d’étude à l’EHESS précise que l’on commence à peine à étudier ces biais. La littérature scientifique postule le plus souvent que ces dimensions sont uniquement biologiques, alors qu’elles sont éminemment sociales. Elle a montré que les recommandations de la Société européenne de cardiologie, s’appuient sur des échantillons cliniques où les hommes sont largement surreprésentés. Elles seront moins adaptées et moins efficace pour soigner les femmes.
Enfin, le troisième mécanisme concerne les conditions d’accès au système de soins et de prise en charge qui sont différentes selon les positions sociales des individus.
La couleur de peau aussi
La position ethnoraciale reste encore fortement négligée, notamment en France. La pandémie de Covid-19 a montré ( Données de l’Insee dès 2020) une forte surmortalité des personnes nées en Afrique subsaharienne par rapport à celles nées en France.
Avec sa collègue épidémiologiste Josiane Warszawski, elle a montré que ce risque n’était pas lié à l’absence de port du masque, ou l’usage du gel ou la distanciation, mais aux conditions de vie de ces personnes immigrées? En cause, la densité des communes de résidence, les logements surpeuplés, les conditions de travail, les transports en commun, des postes d’agents de nettoyage, très exposés au risque de contamination…
Pour aller plus loin
La chercheuse présentera son cycle de cours au Collège de France, où elle traitera de la production sociale des inégalités de santé.
https://www.college-de-france.fr/fr/chaire/nathalie-bajos-sante-publique-chaire-annuelle
Merci à Emmanuelle Picaud et au Collège de France
